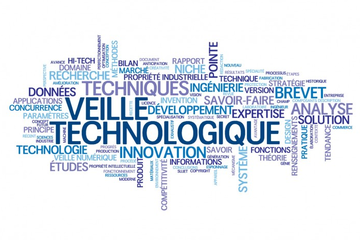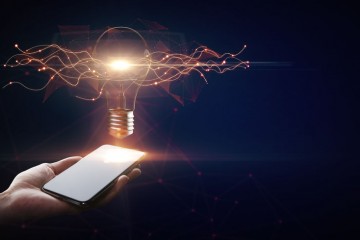-
Vous êtes ici :
- Accueil
- Tag : méthodologie
Tag: méthodologie
Comment trouver des outils de recherche d’information thématiques ?
Il y a un besoin croissant d’outils de recherche thématiques pour la recherche d’information professionnelle. Et fort heureusement, de nombreux outils thématiques se développent depuis quelques années. Dans un article paru en 2017 dans BASES « L’avenir de la recherche sera-t-il thématique ? » - BASES n°351, septembre 2017, nous avions évoqué cette tendance.
Deux ans et demi après, elle se confirme et de nouveaux outils de recherche thématiques continuent de voir le jour. Pour autant, identifier ces outils n’est pas toujours évident, car ils n’ont pas la même visibilité ni la même force de frappe que les grands outils de recherche sur le marché.
Dans cet article, nous proposerons une méthodologie pour identifier des outils de recherche thématiques sur un sujet donné.
Lire aussi :
L’avenir de la recherche sera-t-il thématique ?
Open data : les outils de recherche issus des données de data.gouv.fr
Veille et recherche : le retour de la sélectivité face à la quantité
Ces nouveaux outils qui surfent sur la sélectivité des sources
Comment construire ses propres outils de recherche d'information thématiques ?
Comment construire ses propres outils de recherche d’information thématiques ?
Dans un contexte de surinformation, les outils de recherche généralistes ne sont pas en mesure de répondre seuls à des besoins d’information complexes qui nécessitent d’avoir une vision d’ensemble d’un sujet.
Google effectue une sélection de 100 à 200 résultats qu’il juge les plus pertinents. Les agrégateurs de presse ne disposent pas de toutes les sources pertinentes sur une thématique ou un secteur d’activité. Les plateformes de veille ont une antériorité limitée et ne sont pas conçues pour être des outils de recherche, même si cela évolue un peu depuis quelques années.
Quand on travaille sur des sujets, thématiques ou secteurs d’activité récurrents, on a donc intérêt à se créer ses propres outils de recherche thématiques que l’on peut aller interroger dès qu’une question ponctuelle ou une étude se présente.
Pour illustrer cet article, nous reprendrons notre exemple sur le secteur de la construction en cherchant à construire et mettre en place des outils de recherche thématiques sur la construction et le BTP.
Lire aussi :
ILI 2019 : une vision anglo-saxonne de l’avenir des professionnels de l’information
La curation pour les managers : le sens de l’information vu par Curation Corp
Ces start-ups qui investissent le champ de l’évaluation des sources et contenus
Open data : les outils de recherche issus des données de data.gouv.fr
Veille et recherche : le retour de la sélectivité face à la quantité
Ces nouveaux outils qui surfent sur la sélectivité des sources
« MasterClass Veille & Search 2020 »
Etre un expert de la veille et de la recherche d’information, et maintenir son expertise, est plus que jamais un challenge car le monde de l’information est en perpétuel mouvement.
Les outils de recherche et de veille évoluent très rapidement, de nombreux acteurs apparaissent et disparaissent régulièrement, les sources d’information évoluent et changent de business model, ce qui nécessite une surveillance large de son environnement.
Seule solution : se former et s’informer continuellement afin de connaître les dernières tendances et les meilleures méthodes, sources et outils.
Mettre en place une veille sur les contenus multimédias
Comme nous avons pu le voir, rechercher des contenus multimédias est déjà un défi en soi. Mettre en place une veille sur ces contenus en est un autre.
Les outils de recherche de vidéos, d’images, ou de contenus audio proposent très rarement des fonctionnalités d’alertes et les flux RSS se font plutôt rares ou alors sont très bien cachés.
Les fonctionnalités de veille des outils hébergeant des contenus multimédias
Sur Dailymotion, les flux RSS existaient il y a encore peu de temps, mais ils étaient bien cachés.
Il suffisait d’ajouter /rss après www.dailymotion.com. Malheureusement, nos récents tests montrent que cela ne fonctionne plus...
Lire aussi :
La veille face aux nouveaux médias : podcasts, Stories, Lives, etc.
La révolution multimédia bouscule la veille
Outils de recherche de vidéos : des métadonnées au speech to text
Outils de recherche d’images : des métadonnées à la reconnaissance de texte, d’objets et de visages
Outils de recherche sur les contenus audios : un segment encore pauvre
Comment valoriser les contenus multimédias dans un livrable de veille ?
Comment valoriser les contenus multimédias dans un livrable de veille ?
Une fois les vidéos, images ou contenus audios identifiés dans le cadre d’une veille ou d’une recherche d’information, il n’est pas si simple de les valoriser et notamment d’analyser, sauvegarder, utiliser et retranscrire ces contenus dans ses livrables.
D’une part parce qu’il s’agit souvent de contenus éphémères qui peuvent disparaître du jour au lendemain sans laisser de traces.
Et d’autre part parce qu’il est très difficile de retranscrire ces contenus de manière intelligible et efficace dans un livrable.
Il est en effet peu satisfaisant de transmettre un simple lien vers une vidéo ou un podcast en indiquant que le passage intéressant se situe à la 75e minute...
Quels sont les outils et méthodes existant aujourd’hui pour simplifier cette capitalisation et permettant de tirer parti au mieux de ces contenus dans un contexte de veille et de recherche ?
Lire aussi :
La révolution multimédia bouscule la veille
Outils de recherche de vidéos : des métadonnées au speech to text
Outils de recherche d’images : des métadonnées à la reconnaissance de texte, d’objets et de visages
Outils de recherche sur les contenus audios : un segment encore pauvre
Mettre en place une veille sur les contenus multimédias
Rechercher différemment - Dossier Spécial
La recherche d’information sur le Web en 2019 n’est pas une sinécure et rester à jour sur cette question est un véritable challenge. Ce que l’on croyait acquis il y a 6 mois peut être balayé d’un simple coup de vent, car les méthodes et outils évoluent, changent et disparaissent plus vite que jamais.
Il faut sans cesse se remettre en question, s’informer, se former.
Le modèle de recherche d’information classique sur les moteurs, les médias sociaux et les serveurs et bases de données à partir de requêtes par mots-clés a encore de beaux jours devant lui. Même si rien n’est jamais acquis et qu’il faut surveiller attentivement les différentes évolutions liées à ces outils et méthodes.
Lire aussi :
Tracer ses recherches pour gagner en expertise et en productivité
Trois nouveaux outils de recherche au banc d’essai
La recherche d’information par géolocalisation
Optimiser sa veille avec des extensions Chrome ou Firefox
Depuis des années, les extensions de navigateurs (principalement sur Firefox et Chrome) permettent aux veilleurs d’optimiser leurs veilles, leurs recherches et collectes d’informations.
Elles peuvent ainsi jouer un rôle aussi bien au niveau de la surveillance de pages Web, la traduction instantanée de contenu, la détection de flux RSS, l’identification d’articles académiques en libre accès, l’extraction de données, la recherche d’images, etc.
Si les utiliser est souvent un jeu d’enfants, réussir à identifier les plus pertinentes pour son travail quotidien est une autre paire de manches…
Tracer ses recherches pour gagner en expertise et en productivité - Dossier spécial Rechercher différemment
Quand on effectue des recherches d’information dans un cadre professionnel, il ne subsiste bien souvent que le livrable final qui ne contient que les informations jugées pertinentes à un instant T pour un sujet donné. Ce livrable est généralement conservé, archivé et on peut dans ce cas le retrouver et effectuer des recherches sur son contenu si besoin est.
Mais la recherche représente bien plus que cela et ne peut se limiter à ce document final et ce qu’il contient : en amont, il y a différentes requêtes testées sur différents outils de recherche, des sites et pages Web visités, des informations et sources mises de côté, d’autres éliminées, une navigation de site en site, de page en page ou de document en document, etc.
Il est de plus en plus rare de garder des traces précises, détaillées et structurées de tout le cheminement de la recherche. Cheminement qui est d’ailleurs de moins en moins linéaire et de plus en plus « brouillon » ou, du moins, qui fonctionne de plus en plus par tests et investigations successives. Il y a bien eu une époque où les stratégies et résultats de recherche étaient sauvegardés et capitalisés dans des bases de données internes. Mais personne n’y allait jamais et ces projets ont généralement été abandonnés.
La problématique et les difficultés rencontrées pour remonter le fil de ses recherches antérieures n’ont pas pour autant disparu.
Lire aussi :
Rechercher différemment - Dossier Spécial
Trois nouveaux outils de recherche au banc d’essai
La recherche d’information par géolocalisation
La publicité masquée pollue-t-elle la veille ?
Il y a d’un côté la publicité officielle : encarts publicitaires dans la presse, spots TV et radio, résultats sponsorisés sur les moteurs et réseaux sociaux, publicités en display sur des sites, etc. Même si elle dispose toujours d’un espace spécifique, nous avons pu constater que la distinction entre information et publicité n’était pas toujours aussi claire.
De l’autre, il y a une autre catégorie de publicité bien plus trompeuse, non régulée et qui ne coûte pratiquement rien à ceux qui la diffusent, si ce n’est du temps. Les entreprises et les marques auraient donc tort de s’en priver.
Mais les consultants, les freelance cherchent, et trouvent, eux aussi, des moyens détournés pour faire connaître leurs activités et services ; ils n’hésitent plus à mêler contenu informatif, parfois même très intéressant et autopromotion.
Quelles sont ces méthodes qui s’apparentent à de la publicité déguisée ? Où les trouve-t-on ? Quel impact cela a-t-il sur la veille et la recherche d’information ? Comment les repérer et à quoi faut-il faire attention ?
Lire aussi :
Information et publicité : des liaisons dangereuses pour la veille ?
La pige publicitaire : un marché très fermé
Focus sur le format “Story” : une vraie opportunité pour la veille ou simple intrusion des marques dans l’information ?
Publicité Web : un secteur en forte croissance à ne pas négliger pour la veille
Comment évaluer la fiabilité des sources dans des pays dont on ne connaît pas la langue ?
Deux phénomènes ont marqué le monde de la veille ces trente dernières années :
- Tout d’abord, l’internationalisation de la demande de veille du client.
- Ensuite, les possibilités impressionnantes de recherche dans toutes les langues, même les plus reculées, offertes via les outils de traduction automatique.
L’internationalisation de la demande de veille du client
L’entreprise explore un champ d’action et d’innovation de plus en plus étendu géographiquement, mondialisation oblige.
L’enjeu pour un veilleur ou un analyste est aujourd’hui d’accompagner ce mouvement stratégique dans le jeu économique mondial en suivant aussi bien les pays anglo-saxons que les pays ou continents dont il a peu de chances de connaître les langues. Nous entendons ici aussi bien les pays dits émergents qu’en fort développement (zone Asie, Moyen-Orient, Amérique Latine…)
Lire aussi :
La veille et la recherche d'information à l'ère des « fake news » et de la désinformation
Les géants du Web face aux « fake news »
Tirer parti du fact-checking et du journalisme d'investigation pour la veille et la recherche d information
Les outils de veille et de recherche professionnels face à la fiabilité des sources
Ces start-ups qui investissent le champ de l'évaluation des sources et contenus
Panorama : Presse, réseaux sociaux, contenus multimédia, littérature scientifique, données, ... : rechercher sur des contenus très disparates
Qui n’a jamais rêvé d’un outil de recherche ou de veille unique, multi sources et multi contenus qui, à partir d’une seule requête, fournirait l’intégralité des résultats utiles et pertinents sur un sujet donné ?
Si cette question occupe les outils de recherche et éditeurs de veille depuis des décennies, force est de constater que la possibilité de rechercher en un seul et même endroit sur des contenus toujours plus nombreux et disparates reste un idéal vers lequel la plupart cherchent toujours à tendre.
Mais peut-on vraiment rechercher et faire de la veille de la même manière et avec la même méthode sur des contenus très différents qui n’ont pratiquement rien en commun ? Ne se retrouve-t-on pas finalement à devoir effectuer des recherches très basiques voire dégradées car il n’existe pas ou pratiquement pas de dénominateur commun à tous ces contenus ? Comment tirer parti de ces corpus toujours plus larges et disparates pour continuer à réaliser des recherches précise et des veilles de qualité ?
Lire aussi :
Google ajoute deux nouveaux opérateurs de recherche
Quand peut-on clore sa recherche l'esprit tranquille ?
Search Lab : 3 méthodologies clé en main
Comment détecter des innovations de marché ?
La recherche d information appliquée aux personnes
Quand peut-on clore sa recherche d’information l’esprit tranquille ?
La recherche d’information a toujours été une activité chronophage, que ce soit à l’époque du « tout manuel » ou encore aujourd’hui, à l’heure de la profusion d’outils puissants et des gisements considérables d’information, accessibles facilement.
La question de la performance de la recherche d’information et de son évaluation demeure :
Quand peut-on raisonnablement considérer que sa recherche d’information est suffisamment performante et que poursuivre n’apporterait rien d’essentiel «en plus» ?.
Lire aussi :
Presse, réseaux sociaux, contenus multimédia, littérature scientifique, données, etc. : rechercher sur des contenus très disparates
Google ajoute deux nouveaux opérateurs de recherche
Search Lab : 3 méthodologies clé en main
Comment détecter des innovations de marché ?
La recherche d information appliquée aux personnes
Search Lab : 3 méthodologies de recherche clé-en main
A l’occasion du dernier salon i-expo qui s’est tenu en mars dernier, FLA Consultants a organisé un atelier dédié à la recherche d’information et la veille.
Lors de ce workshop, à la fois théorique et opérationnel, les intervenants ont présenté trois études de cas concrètes , que nous reprenons dans ce numéro sous la forme d'articles méthodologiques :
Lire aussi :
Presse, réseaux sociaux, contenus multimédia, littérature scientifique, données, etc. : rechercher sur des contenus très disparates
Google ajoute deux nouveaux opérateurs de recherche
Quand peut-on clore sa recherche l'esprit tranquille ?
Comment détecter des innovations de marché ?
La recherche d information appliquée aux personnes
Comment détecter des innovations de marché ?
La veille concurrentielle et sectorielle est une activité assez classique pour toute organisation mais on a vu ces dernières années une importance grandissante accordée à la détection des innovations produits ou marketing, et ce quel que soit le domaine. Mais dans ce type de veille, on est confronté d’emblée à plusieurs difficultés.
Tout d’abord, l’innovation n’ayant pas de frontières, il s’agira la plupart du temps de mettre en place une veille internationale et multilingue.
Certes, l’anglais et le français pourront couvrir une bonne partie du sujet, mais on obtiendra des résultats beaucoup plus satisfaisants en identifiant le bon vocabulaire dans de nombreuses langues et également les sources productives en langue locale.
Lire aussi :
Presse, réseaux sociaux, contenus multimédia, littérature scientifique, données, etc. : rechercher sur des contenus très disparates
Google ajoute deux nouveaux opérateurs de recherche
Quand peut-on clore sa recherche l'esprit tranquille ?
Search Lab : 3 méthodologies clé en main
La recherche d information appliquée aux personnes
La recherche d’information appliquée aux personnes
Les professionnels de l’information se retrouvent fréquemment confrontés d’une manière ou d’une autre à des recherches d’informations appliquées aux personnes.
En premier lieu, tout le monde ou presque va penser à aller interroger Google à tel point que cela est entré dans le langage courant avec l’expression « Googler » ou « googliser » le nom de quelqu’un.
Mais derrière son apparente facilité, la recherche d’information liée aux personnes ne se limite pas à entrer le nom et le prénom d’une personne dans un moteur de recherche. Les problématiques sont multiples et les outils et méthodes à utiliser le sont aussi
Lire aussi :
Presse, réseaux sociaux, contenus multimédia, littérature scientifique, données, etc. : rechercher sur des contenus très disparates
Google ajoute deux nouveaux opérateurs de recherche
Quand peut-on clore sa recherche l'esprit tranquille ?
Search Lab : 3 méthodologies clé en main
Comment détecter des innovations de marché ?
Enrichir la veille avec des contenus multimédia
Véronique Mesguich est consultante-formatrice et auteur de l’ouvrage « Rechercher l’information stratégique sur le web : sourcing, veille et analyse à l’heure de la révolution numérique », DeBoeck, 2018
La veille concurrentielle fait appel aux images pour repérer de nouveaux produits, ou de nouveaux usages, notamment en b-to-c. Le repérage de tendances ou de phénomènes émergents s’appuie sur des images ou vidéos issues des réseaux sociaux, et notamment Pinterest.
La recherche d’experts se base entre autres sur des captations de conférences, ou interviews partagées sur YouTube et autres réseaux, mais aussi via des podcasts d’émissions de radio ou TV.
Images et vidéos sont souvent synonymes de divertissement. Pour autant, les contenus multimédia, toujours plus nombreux et divers sur le web, sont indispensables dans la pratique de la recherche d’information stratégique et de la veille.
Lire aussi :
Presse, réseaux sociaux, contenus multimédia, littérature scientifique, données, etc. : rechercher sur des contenus très disparates
Google ajoute deux nouveaux opérateurs de recherche
Quand peut-on clore sa recherche l'esprit tranquille ?
Search Lab : 3 méthodologies clé en main
Comment détecter des innovations de marché ?
La recherche d information appliquée aux personnes
Google ajoute deux nouveaux opérateurs de recherche
Google vient d’annoncer le lancement de deux nouveaux opérateurs de recherche liés à la recherche par date.
Il s’agit de des opérateurs before:AAAA-MM-JJ ou before:AAAA/MM/JJ et after:AAAA-MM-JJ ou after:AAAA/MM/JJ pour rechercher des résultats publiés avant ou après une certaine date.
Par exemple, after:2019-04-02 permet de limiter aux résultats publiés après le 2 avril 2019.
On peut également utiliser la syntaxe before:AAAA et after:AAAA et le moteur recherchera alors tout ce qui a été publié après le 1er janvier de l’année en question.
Cette fonctionnalité très utile, même si les dates de publication estimées par Google ne sont pas toujours parfaitement exactes, existe dans les filtres de Google depuis de nombreuses années. On peut en effet se rendre dans l’onglet Outil puis Date et choisir « moins d’1h », « moins de 24h », « moins d’une semaine », « moins d’1 mois », « moins d’un an » ou « période personnalisée ».
Néanmoins, ces nouveaux opérateurs vont permettre d’utiliser des limitations par date là où ce n’était pas possible auparavant et notamment dans les alertes Google ou Google sur mobile.
Lire aussi :
Presse, réseaux sociaux, contenus multimédia, littérature scientifique, données, etc. : rechercher sur des contenus très disparates
Quand peut-on clore sa recherche l'esprit tranquille ?
Search Lab : 3 méthodologies clé en main
Comment détecter des innovations de marché ?
La recherche d information appliquée aux personnes
Bien interroger les outils de recherche gratuits : une multitude de méthodes - Dossier spécial Recherche d'Information
Si, comme nous avons pu le voir, le paysage des outils de recherche a évolué, c’est également la façon de les interroger qui a beaucoup changé en quelques années.
Au départ, tous les outils ou presque proposaient au minimum une recherche booléenne simple.
Par recherche booléenne, nous faisons référence ici à des requêtes structurées plus ou moins longues où l’on combine des mots-clés grâce aux opérateurs booléens classiques AND, OR, NOT mais aussi des opérateurs avancés (opérateur de proximité, recherche dans le titre, recherche sur un type de fichier, troncature, etc.).
Lire aussi :
Un regain d’énergie et de vitalité pour les outils de recherche
Google évolue, les documentalistes plus utiles que jamais
Comment bien interroger Google en 2018
L'information sur le Web est éphémère : quel impact et quelles solutions pour la recherche d’information ?
Découvrez dans cet article deux cartographies de Bases Publications sur les différentes méthodes de recherche offertes par les moteurs de recherche gratuits, généralistes, spécialisés, académiques et moteurs de réseaux sociaux.
Recherche-t-on différemment à l’heure du « Mobile First » ?
Les pratiques des internautes évoluent vers toujours plus de recherches et de navigation sur mobile, qu’il s’agisse de smartphones ou de tablettes. De fait, les grands acteurs du Web, que ce soit les moteurs, les réseaux sociaux ou encore les sites de e-commerce orientent toujours un peu plus leur stratégie et leurs innovations vers ces supports mobiles.
Si ces tendances s’observent dans la sphère grand public, il est plus difficile de voir quel peut être l’impact dans la sphère professionnelle et plus particulièrement sur la recherche d’information et la veille professionnelle. C’est pour cette raison que nous avons choisi de nous y intéresser dans ce nouveau numéro de NETSOURCES.
Lire aussi :
Veille et recherche d’information en mobilité : quelles solutions offrent les outils professionnels ?
Les challenges qui attendent les professionnels de la veille et de la recherche d’information en 2019
« Rechercher l’information stratégique sur le web » : votre nouveau guide au quotidien
Rechercher l’information stratégique sur le web
L’information sur le Web est éphémère : quel impact et quelles solutions pour la recherche d’information ?
Quand on recherche de l’information sur le Web, on a souvent l’impression que tout ce qui a, un jour, été publié sur le Web ouvert doit pouvoir se retrouver d’une manière ou d’une autre, notamment en tirant parti des fonctionnalités avancées des moteurs de recherche comme Google. Or l’information sur le Web ouvert est bien plus éphémère qu’on ne pourrait le croire...
Dans la réalité, une très grande partie de ce qui a été publié sur le Web dans les années 1990 et 2000 n’existe plus en tant que tel. Les sites Web ont été refaits ou ont tout simplement disparu. Et de fait, bon nombre de ces contenus sont désormais inaccessibles par les moteurs de recherche classiques.
Comment retrouver sur le Web des articles de presse écrite au format original ?
La recherche d’articles de presse est un exercice classique pour les professionnels de l’information.
Pour autant, s’il existe de multiples outils et méthodes pour retrouver en ligne le contenu textuel d’articles parus dans des revues et journaux papier, cela s’avère nettement plus compliqué lorsque l’on souhaite retrouver les articles avec leur mise en page originale.
Quelles méthodes et stratégies de recherche utiliser pour retrouver sur le Web des articles de presse papier dans leur format original ? Et de quelles sources et outils dispose-t-on ?
Veille et recherche d’information : Comment trouver les bons mots-clés ?
Il existe aujourd’hui de multiples manières de rechercher de l’information et cela ne se limite plus à l’insertion de mots-clés dans une boîte de recherche : on peut utiliser des images, des sons, des blocs de texte, tirer parti de recommandations automatiques, etc.
Les grands moteurs de recherche Web comme Google et Bing notamment, dont le développement se focalise toujours un peu plus vers la recherche mobile et vocale ont fait évoluer la façon dont il est possible de les interroger. Et le recours à l’intelligence artificielle chez ces mêmes moteurs permet d’ailleurs une meilleure compréhension de l’intention de l’utilisateur et par là-même une simplification potentielle des requêtes.
Recherche sur les réseaux sociaux : quelles solutions gratuites ?
Rechercher sur le Web classique est une chose ; effectuer des recherches sur les réseaux sociaux en est une autre.
Si les moteurs de recherche classiques comme Google et Bing sont adaptés à la recherche sur les sites Web tels que les sites d’entreprises, sites institutionnels, sites d’actualités, blogs, forums, ils ne sont pas d’une très grande utilité lorsque l’on souhaite obtenir des résultats issus de réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest ou encore LinkedIn.
Rechercher des articles scientifiques anciens : entre intuition et méthodologie
Quand on dispose de la référence bibliographique d’un article scientifique, il n’est souvent pas très difficile d’identifier et d’obtenir l’article en texte intégral même si cela a un coût.
Dans la majorité des cas, une simple recherche sur le titre de l’article dans un moteur de recherche généraliste, comme Google ou Bing, ou dans un moteur de recherche académique, comme Google Scholar, permet d’identifier rapidement le PDF de l’article en ligne, qu’il soit accessible gratuitement ou de façon payante sur le site de l’éditeur.
Mais parfois, retrouver un article scientifique, surtout quand il est ancien, relève du parcours du combattant. Ce n’est pas pour autant impossible...
A la recherche de ces « chères » études de marché
Les études de marché offrent une forte valeur ajoutée car elles associent à la fois un travail de compilation de données précieuses et une analyse approfondie.
Mais elles ont la réputation d’être chères, très chères même. Faut-il pour autant faire une croix sur ces sources si l’on ne dispose pas d’un budget suffisant ou d’un accès aux principales sources et bases de données qui en proposent?
Dans cet article, nous avons choisi de proposer un panorama de l’offre en matière d’études de marché, qu’elles soient accessibles en ligne gratuitement ou selon un modèle traditionnel payant, tout en analysant les avantages et limites de ces différentes solutions.
- Comment interroger le Web pour obtenir des études de marché gratuites ou très bon marché ?
- Qui sont ces acteurs qui proposent des abonnements « abordables » pour accéder à des études ? Qu’est-ce que cela inclut vraiment ?
- Quelles sources proposent des études de marché payantes et souvent très onéreuses : cabinets d’études, agrégateurs d’études, bases de données, etc. Et surtout comment peut-on évaluer a priori la qualité et la valeur ajoutée d’une étude, la réputation de son éditeur avant d’y mettre le prix ?
Comment bien interroger Google en 2018 ?
Dans un article publié sur notre blog « Google évolue : les documentalistes plus utiles que jamais », nous faisions le constat que Google affiche toujours moins de résultats et ce, quelle que soit la requête et alors que son index ne cesse pourtant de s’accroître.
Il annonce certes dans un premier temps des centaines de milliers voire des millions de résultats mais en se rendant sur la dernière page de résultats, on constate que leur nombre ne dépasse pratiquement jamais les 500.
Pour preuve, nous avions réalisé en 2011 une recherche sur les masques respiratoires. A l’époque, une requête sur l’expression masque respiratoire permettait de visualiser plus de 1 000 résultats dans Google. Aujourd’hui, la même requête n’en génère que 183.
Peut-on se limiter à une veille sur les médias sociaux ? Le cas des projets éoliens
On voit paraître régulièrement sur le Web et dans la presse des études et sondages sur les pratiques informationnelles des internautes sur le Web et les médias sociaux.
Un rapport du sérieux Pew Research Center publié cet été sur l’usage des médias sociaux dans l’accès à l’information montrait que 67% des américains s’informaient via les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp) et la moitié d’entre eux sur Facebook.
Les médias traditionnels n’en étaient pas pour autant délaissés mais perçus comme un complément. Cette tendance ne s’applique d’ailleurs pas qu’aux américains mais bien à travers le monde entier.
Se former au-delà des frontières de l’infodoc
On ne le répétera jamais assez mais se former en permanence à de nouvelles compétences est une qualité essentielle des professionnels de l’information.
Mettre à jour ses connaissances en veille, recherche d’informations ou tout autre sujet relatif à l’infodoc est bien évidemment indispensable, mais il serait dommage de s’y restreindre et de ne pas aller explorer des domaines annexes (formation, communication, etc.).
« Sortir de sa zone de confort »
Cette idée d’article nous avait été suggérée par un visiteur d’un précédent salon i-expo qui nous avait expliqué les difficultés à identifier des formations dès lors que l’on sort du champ traditionnel de l’infodoc.
Tirer parti de la recherche visuelle et d’images pour la veille
Quand on pense recherche d’information et veille, on pense généralement au texte et moins à l’image. Dans l’imaginaire collectif, la recherche de contenus visuels renvoie davantage à l’iconographie et aux applications grand public qu’à un usage professionnel. Le lien entre les images et la veille concurrentielle et stratégique n’est pas une évidence...
Les outils du Web dédiés aux images (moteurs de recherche, bases de données, réseaux sociaux) ne sont pas nouveaux mais ils ne cessent de se multiplier et de se perfectionner. Le développement de l’intelligence artificielle y est pour quelque chose.
D’autre part, on remarque ces derniers temps une tendance prenant toujours plus d’ampleur : la recherche visuelle. On ne cherche plus seulement des images à partir de contenu textuel (mots-clé) mais l’image elle-même peut devenir le point de départ de la recherche en lieu et place des mots-clés.
Scopus aide gratuitement à identifier les auteurs et leurs publications
Scopus est un agrégateur de références d’articles scientifiques qui propose 69 millions de références issues de 22 000 publications de plus de 5 000 éditeurs.
L’accès au service est payant, le modèle étant celui du forfait annuel souscrit par des Universités, des entreprises…
Outre l’accès payant, Scopus offre un service gratuit d’identification d’auteur, basé, bien sûr, sur l’ensemble de son fonds.