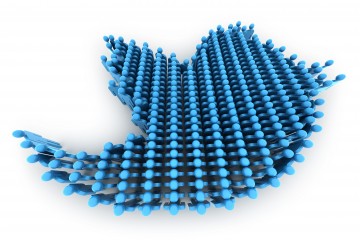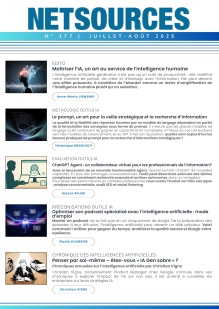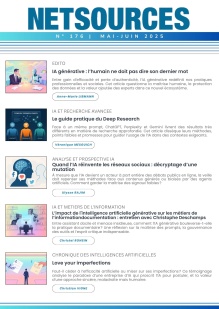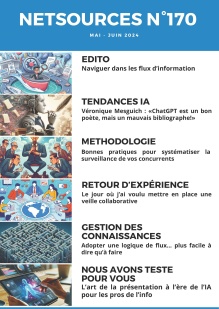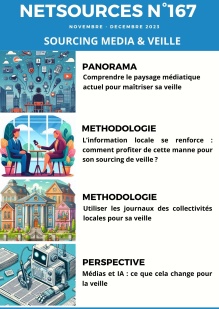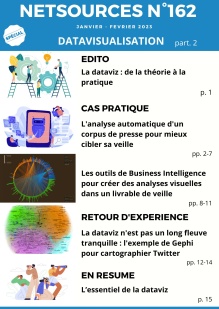-
Vous êtes ici :
- Accueil
- Publications
- Netsources
Sélectionner le numéro de "Netsources" à afficher
Elcurator : la curation en mode entreprise
Les fondateurs définissent Elcurator comme un « outil collaboratif de veille et de curation ».
A l’origine du projet, on trouve deux ingénieurs français travaillant pour le cabinet Octo Technology et qui avaient développé en interne un outil de curation et de collaboration. A partir de l’été 2014, ils décident de proposer cet outil à d’autres entreprises et au grand public sous le nom d’« Elcurator ».
Nous présenterons en détail cet outil qui ne manque pas d’atouts et le comparerons à ses concurrents les plus directs (Stample ou encore Scoop-it).
Un outil simple et efficace
Le principe de base de l’outil consiste à partager des contenus avec d’autres utilisateurs.
Même si l’outil permet de partager des contenus de manière publique avec les internautes, nous nous focaliserons ici sur le partage privé à un nombre restreint d’utilisateurs identifiés (collègues, partenaires, clients, etc.), ce qui a un réel intérêt pour les entreprises.
Elcurator propose 3 types de comptes :
- Gratuit : très limité avec seulement 5 utilisateurs, 50 contenus archivés, 200 Mo de fichiers stockés, les fonctionnalités standard et pas d’extraction de contenu (copie d’écran ou extraction du contenu pour pouvoir le lire plus tard hors connexion ou pour le retrouver si la page a disparu)
- Essentiel : utilisateurs illimités, contenus archivés illimités, 10 Go de fichiers stockés et extraction de contenu. 2 euros / mois par utilisateur actif (personne qui a lu ou partagé du contenu au moins une fois dans le mois). A noter qu’il faut dépenser un minimum de 20 euros par mois.
- Entreprise : mêmes fonctionnalités avec un peu plus de stockage pour les fichiers (50 Go), l’interface est personnalisée aux couleurs de l’entreprise et les utilisateurs disposent d’un outil d’analyse des tendances. 3 euros / mois par utilisateur actif (avec un minimum de dépenses de 200 euros par mois)
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
La twittliste du secteur pharmaceutique
L’industrie pharmaceutique, et plus largement les problématiques de santé liées au médicament, sont bien présentes sur Twitter.
Il faut dire qu’il s’agit d’un domaine au poids économique mondial très élevé, et toujours croissant, sans même parler des enjeux sociaux et politiques.
La taille du marché mondial était ainsi évaluée à 639 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2013 (chiffre de l’organisation des entreprises du médicament), et s’il reste dominé par l’Amérique du Nord (41% des ventes de médicaments) et l’Europe (26,7%), les pays émergents représentent une part de plus en plus importante des ventes de médicaments. La société IMS Retail Drug Monitor notait ainsi pour l’année 2013 une croissance de 17% et 14% des marchés brésiliens et chinois, à comparer avec une croissance de 3% du marché américain.
L’objectif des Twittlistes mises en place par l’équipe de Netsources est d’offrir un panorama du secteur concerné tout en profitant de la force de Twitter : son instantanéité, mais aussi sa capacité à inclure des personnes (qu’il s’agisse de journalistes, d’influenceurs ou de patrons d’entreprises) et des institutions dans le processus de veille. Vous pourrez retrouver cette liste sur notre compte Twitter, à l’adresse : https://twitter.com/FlaTeam/lists/secteur-pharmaceutique
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
MEED, une ressource incontournable sur le Moyen-Orient
La recherche d’informations et la veille portant sur le Moyen-Orient n’est pas une mince affaire notamment en raison de la barrière de la langue, de la méconnaissance des sources locales et du contrôle de l’information souvent mis en place par les gouvernements de ces pays.
Une des ressources incontournables sur cette région s’appelle MEED (Middle East Business Intelligence) et présente l’immense avantage de proposer de très nombreuses ressources en langue anglaise qui couvrent le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
Le site propose quelques ressources en libre accès mais pour profiter de l’ensemble du contenu, il faut souscrire un abonnement (à partir de 1 500 dollars par an).
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
Sommaire mai/juin 2016
PANORAMA • La recherche d’informations financières et stratégiques sur les entreprises : sources et méthodologie
MÉTHODOLOGIE • Veille à l’international : comment trouver les bonnes sources d’information locales ?
COMPTE-RENDU DE SALON/CONFÉRENCE • ICI Conférence : « Façonner l’avenir par l’Intelligence Économique »
TENDANCES • DataSift : une nouvelle étape dans l’accès aux données des utilisateurs de Facebook ?
AGENDA • DocExpo : le 1er salon virtuel de la veille, de la documentation et de la gestion de l’information
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
La recherche d’informations financières et stratégiques sur les entreprises : sources et méthodologie
Le besoin d’information sur les entreprises (qu’elles soient concurrentes, prospects, fournisseurs, etc.) concerne aussi bien les professionnels de la veille et de l’intelligence économique que d’autres fonctions de l’entreprise (top management, marketing, direction commerciale, etc.)
Avec la quantité d’informations disponibles gratuitement sur le Web ouvert, il n’est aujourd’hui pas très difficile de trouver des informations de base sur une entreprise (sauf si elle est de très petite taille avec des activités peu originales - artisan boulanger par exemple) mais dès qu’il s’agit d’informations plus complexes et stratégiques (comptes consolidés, structure d’actionnariat, fusions/acquisitions, ratios financiers, etc.), la tâche s’avère beaucoup plus ardue d’autant plus si la société est une entreprise privée et n’est pas basée en Europe.
Dans cet article, nous aborderons dans un premier temps la question des types d’information dont on peut avoir besoin sur une entreprise et les éléments de contexte à prendre en compte (les contraintes réglementaires en matière de publication de comptes varient par exemple considérablement d’un pays à l’autre).
Nous effectuerons ensuite un panorama des sources gratuites (au niveau français et international) proposant de l’information sur les entreprises et présenterons les limites de ces sources.
Nous nous intéresserons alors aux principales sources d’informations payantes (bases de données, fournisseurs d’information, portails d’information, etc.).
L’article se finira sur un exemple concret de méthodologie de recherche sur une société de télécommunications africaine.
Entreprises : quelles informations ?
Le besoin d’informations sur une entreprise recouvre des réalités très diverses. Avant toute chose, il convient de se demander ce que l’on cherche réellement et dans quel but (les simples noms des dirigeants, les comptes consolidés, des rapports d’analystes, etc.).
Nous avons listé ci-dessous toute une série d’informations qui peuvent être utiles dans le cadre d’une veille concurrentielle, stratégique, etc.
Des informations de « premier niveau »
- nom de l’entreprise (actuel et éventuellement ancien nom) ;
- nom des filiales ou de la maison-mère ;
- effectif global ;
- localisation du siège et implantation des autres structures (usines, bureau d’étude, etc.) ;
- noms des dirigeants ;
- état d’endettement ;
- actes & statuts ;
- comptes annuels / comptes consolidés ;
- informations relatives à l’existence éventuelle d’une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire ;
- extrait KBIS (pour la France uniquement) ;
- actualités de l’entreprise (dépêches et articles de presse) ;
- liste des concurrents ;
- forme juridique ;
- année de création ;
- information de contact ;
- rapport du conseil de surveillance (quand applicable) ;
- rapport des commissaires aux comptes (quand applicable) ;
- données boursières (quand applicable).
Des données plus analytiques ou requérant des connaissances de recherche plus pointues :
- prévisions financières ;
- recommandations de courtiers ;
- ratios financiers de rentabilité, de marge, de productivité ;
- ratings et indicateurs de solidité financière ;
- structure d’actionnariat détaillée avec le nom des administrateurs et dirigeants ;
- informations sur les PEP (Personnalités exposées politiquement) et les sanctions
- informations sur les fusions-acquisitions ;
- données de propriété intellectuelle (brevets et marques déposées) ;
- rapports sectoriels et prévisions macro-économiques ;
- documents originaux numérisés ;
- données d’import/export ;
- appels d’offres (publiés et remportés par l’entreprise) ;
- rapports d’analystes ;
- analyses SWOT.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
Veille à l’international : comment trouver les bonnes sources d’informations locales ?
La veille sur un pays étranger, qu’elle soit d’ordre économique, concurrentielle ou sectorielle, représente souvent une véritable épreuve et ce, même quand on maîtrise correctement la langue du pays en question.
Quand on se trouve en terrain connu (en l’occurrence dans son propre pays), on sait généralement où chercher ou du moins, on connaît quelques sources de référence qui vont pouvoir ensuite nous aiguiller rapidement dans la bonne direction et vers les bonnes ressources. Dans un univers qui nous est complètement étranger ou presque, on sait ce que l’on cherche (au moins approximativement) mais on ne sait pas où chercher et surtout par où commencer.
On pourra bien évidemment commencer par explorer des sources internationales (serveurs et bases de données internationales, sites des grandes organisations internationales, ambassades, etc.) qui traitent du pays en question mais il serait dommage de se priver des sources d’informations locales qui sont généralement très complémentaires.
Dans cet article, nous montrerons comment identifier des sources locales donnant accès à la presse locale, aux données économiques, aux études de marché, rapports, statistiques, informations sur les entreprises, revues scientifiques et académiques ou encore quelles sont les informations les plus souvent recherchées.
Nous nous focaliserons ici exclusivement sur l’identification de bases de données (gratuites et payantes) et fournisseurs d’informations locaux qui sont souvent un bon point d’entrée vers l’information locale.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
DataSift : une nouvelle étape dans l’accès aux données des utilisateurs de Facebook ?
Plusieurs sociétés, dont le suisse Faveeo ou encore Synthesio, se sont associées avec DataSift, le spécialiste en Big Data, afin de mettre en place une plateforme de monitoring pour Facebook.
L’objectif est simple, et potentiellement très prometteur : permettre aux marques un accès facilité à l’ensemble des données publiées sur Facebook (qu’elles soient publiées sur des comptes privés ou des pages ou groupes publics). Pour des questions de protection de vie privée, ces données sont anonymisées, mais offrent tout de même un accès à près de 65 attributs (sexe, âge, localisation…).
Cette solution est d’autant plus intéressante qu’il est de plus en plus difficile de surveiller Facebook dans le cadre d’une veille.
S’il était possible il y a encore quelques années de mettre sous surveillance des pages publiques, des groupes, des statuts publics et mêmes des résultats de recherche via des outils de veille spécialisés sur les médias sociaux, cela n’est plus le cas depuis près d’un an lorsque Facebook a subitement décidé de limiter les contenus accessibles via son API. Seules les pages publiques sont encore accessibles par ces outils.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
ICI Conference : « Façonner l’avenir par l’Intelligence Economique »
L’Institute for Competitive Intelligence (ICI) a organisé les 20 et 21 avril derniers à Bad Nauheim (près de Francfort), et ce pour la 8ème année consécutive, sa « Conférence Internationale en Intelligence Economique ».
La conférence a réuni un public très ciblé de professionnels travaillant dans le domaine de la recherche et de la valorisation de l’information : des professionnels du traitement de l’information, des spécialistes des marchés ou de différents secteurs industriels, de l’innovation technologique, R&D mais aussi des chercheurs universitaires spécialisés dans l’intelligence économique.
Selon le format habituel, la conférence s’est déroulée sur deux jours avec plus de 30 ateliers différents, les conférenciers venant de différentes régions du monde : France, Allemagne, Angleterre, Belgique, Pays Bas, Suisse, Autriche, Etats-Unis, Brésil, Israël, Afrique du Sud, Colombie, Japon et Inde. Les ateliers étaient des études de cas, des présentations scientifiques, ou sous forme de tutoriaux (présentées par les éditeurs de logiciels), des « impulse speeches » 1, des récits de meilleures pratiques, des sessions de networking et discours d’experts.
Des séances de formation étaient organisées également par l’Institute for Competitive Intelligence (ICI), avant et après la conférence, qui portaient sur des méthodologies de recherche innovantes, des outils et astuces, bonnes pratiques de niveau expert ou intermédiaire : « Comment trouver des informations sur le web en dehors de Google (recherche avancée, médias sociaux, blogs, ..), « L’intelligence économique et l’utilisation des outils d’analyse stratégique », « Les principes de l’intelligence technologique », etc.
Parallèlement à la conférence se tenait un salon de taille réduite où exposaient certains fournisseurs de solutions logicielles d’intelligence économique Français et européens (tels que KB Crawl, M-Brain, AMI Software, …), des plateformes de recherche de données de type Findout et d’autres acteurs tel que l’Office Européen des brevets.
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
DocExpo : le 1er salon virtuel de la veille, de la documentation et de la gestion de l’information
Le Centre National de Documentation marocain, sous tutelle du Haut-Commissariat au Plan, organise pour la toute première fois un salon virtuel dédié au domaine de l’information-documentation qui ouvrira ses portes à partir du 1er juillet 2016.
Près de 150 exposants seront présents, répartis au sein de 10 halls thématiques.
Les Thématiques
- Documentation
- Data
- Veille
- Bibliothèques / Médiathèques
- Bases de données numériques
- Archivage
- Formation / e-learning
- Publication / Diffusion / Edition
- Contenu médias sociaux
- Gouvernance documentaire et informationnelle
 FLA est heureux d’annoncer son soutien et sa participation à ce salon innovant
FLA est heureux d’annoncer son soutien et sa participation à ce salon innovant
Informations supplémentaires
La liste des exposants présents sur le salon : http://cnd.hcp.ma/docexpo2016/Exposants-stands-Liste-des-demandes-recues_a12.html
Pour plus d’informations, et pour vous inscrire, rendez-vous à cette adresse : http://cnd.hcp.ma/docexpo2016
Sommaire mars/avril 2016
PANORAMA • Les ressources cachées des collectivités territoriales
INSOLITE • Veille et poisson d’avril : et si le piège ne se refermait pas le 1er avril ?
OUTILS DE VEILLE • Visibrain : la tour d’observation des médias en ligne via Twitter
L’ACTU EN BREF • L’actualité des moteurs et du Web social
FICHE PAYS • Sources et Ressources sur l’Ukraine
Déjà abonné ? Connectez-vous...
Connexion
Les Tags de Netsources
- IA
- brevets
- cartographie
- SEO
- open access
- livrables de veille
- humain
- médias sociaux
- sourcing veille
- flux RSS
- professionnel de l'information
- open data
- recherche vocale
- information business
- agrégateurs de presse
- à lire
- conférences salons
- information scientifique et technique
- outils de recherche
- outils de veille
- tendances
- multimédia
- actualités
- méthodologie
- serveur de bases de données
- curation
- due diligence
- recherche visuelle
- outils de traduction
- fake news
- fact checking
- publicité
- géolocalisation
- marques
- appels d'offres
- sommaire
- formation Veille Infodoc
- retour d'expérience
- OSINT
- propriété intellectuelle
- presse en ligne
- recherche Web
- évaluation outils
- références bibliographiques
- résumé automatique
- Bing
- veille collaborative
- veille audiovisuelle
- veille innovation
- infobésité
- études de marché
- données statistiques
- dataviz
- information financière
- LexisNexis
- Newsdesk
- sourcing pays
- veille medias
- veille commerciale
- réseaux sociaux
- newsletter
- veille à l'International
- ist
- ChatGPT
- veille métier
- intelligence économique
- veille concurrentielle
- podcast
- science ouverte
- open source
- veille technologique
- knowledge management
- édito
- Intelligence artificielle
- navigateur IA
- sécurité informatique
- navigateur agentique
- méthodologie et livrables