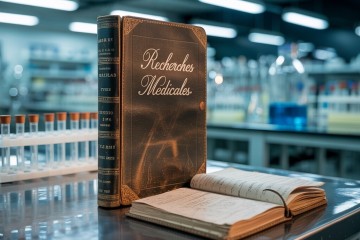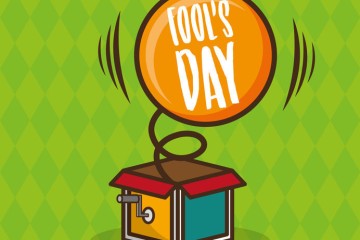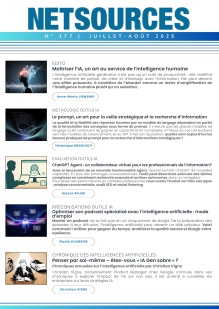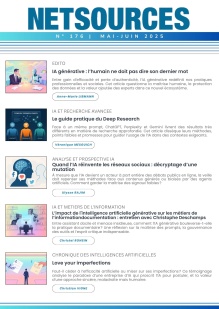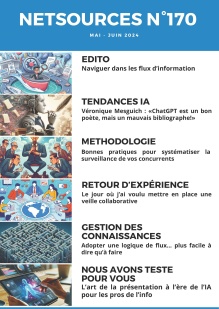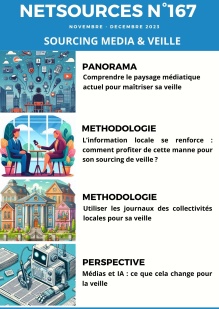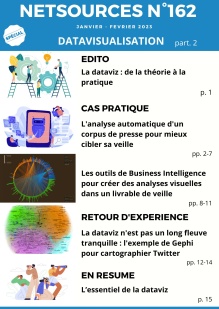En 2009 les lignes directrices de la société européenne de cardiologie recommandaient l’usage des bêta bloquants pour protéger le cœur lors d’opération non cardiaque. Ces lignes directrices étaient déduites d’une série d’études menées depuis 1999. Ces directives ont été modifiées en 2013 à la suite d’une « expression of concern » publiée dans L’European Heart Journal recommandant que ces lignes directrices ne dussent plus être appliquées en routine, mais faire l’objet d’une analyse au cas par cas.
En effet, un article publié en 2014 “ Meta-analysis of secure randomised controlled trials of β-blockade to prevent perioperative death in non-cardiac surgery “ de Bouri, S., Shun-Shin, M. J., Cole, G. D., Mayet, J. & Francis, D. P. Heart 100 , 456-464 (2014). a remis drastiquement en cause les essais réalisés par l’organisme néerlandais DECREASE qui constituaient le socle de ces lignes directrices. Les auteurs ont utilisé pour cela une autre série d’études considérées, elles, comme sûres, réalisées sur un total de 10 529 patients. Les résultats ont montré que l’application des directives de 1999 augmentait la mortalité à 30 jours de 27 %. Les auteurs ont donc recommandé d’abroger sans délai les recommandations de 1999. D’autres auteurs ont considéré que ces mauvaises lignes directrices étaient responsables de jusqu’à 10 000 décès par an au Royaume-Uni.